 SEVERINE, LIBRE COMME L’AIR conférence d'E. Antébi sur cette secrétaire-journaliste de Jules Vallès, directrice du Cri du Peuple, chroniqueuse vedette de La Fronde, journal géré et écrit par des femmes, surnommé "Le Temps en Jupons". Cette grande amoureuse, anarchiste mais fille d'un employé de la préfecture de police, pionnière, courageuse, qui écrivait : « J’aime l’indépendance de l’adversaire autant que la mienne propre ; je conçois que le cerveau du voisin ne soit pas moulé sur le mien. » Qui, lorsqu'on lui demandait si elle était franc-maçonne, répondait "Tout rite m'écarte". Qui, adhérente des premiers jours au Parti communiste le quitte peu après quand le Parti refuse d'adhérer aux Droits de l'Homme". Et qui proclamait : « Moi une rosette sur la poitrine ? Mais la nature m’en a déjà donné deux ! » SEVERINE, LIBRE COMME L’AIR conférence d'E. Antébi sur cette secrétaire-journaliste de Jules Vallès, directrice du Cri du Peuple, chroniqueuse vedette de La Fronde, journal géré et écrit par des femmes, surnommé "Le Temps en Jupons". Cette grande amoureuse, anarchiste mais fille d'un employé de la préfecture de police, pionnière, courageuse, qui écrivait : « J’aime l’indépendance de l’adversaire autant que la mienne propre ; je conçois que le cerveau du voisin ne soit pas moulé sur le mien. » Qui, lorsqu'on lui demandait si elle était franc-maçonne, répondait "Tout rite m'écarte". Qui, adhérente des premiers jours au Parti communiste le quitte peu après quand le Parti refuse d'adhérer aux Droits de l'Homme". Et qui proclamait : « Moi une rosette sur la poitrine ? Mais la nature m’en a déjà donné deux ! » |
SEVERINE, LIBRE COMME L’AIR
(conférence donnée le samedi 10 mars dans la librairie salon de thé de la Porte Saint-Michel, Bécherel, Evelyne le Garrec)
D’abord puisque nous célébrons la Journée de la Femme, je voudrais saluer ces femmes, parfois obscures, qui découvrent une autre femme, et font partager, avec enthousiasme, conviction et une certaine abnégation, leur passion à la fois intellectuelle et, presque, sensuelle. Tel était le cas d’Anne Delbée avec Camille Claudel, tel est celui d’Evelyne Le Garrec avec Séverine : ce sont ses deux livres publiés en 1982 qui ont en grande partie contribué à faire connaître une Séverine dont l’un des mystères reste qu’on n’en parle guère – mais peut-être lèverons-nous un coin du voile tout à l’heure sur les raisons de cette éclipse et de ce silence. Evelyne Le Garrec dont on sait peu de choses et qui a puisé sa matière à la précieuse Bibliothèque Marguerite Durand, du nom de cette passionnée – ni l’une ni l’autre ne sont des passionarias, et c’est une grande différence – qui disait que le féminisme devait beaucoup à ces beaux cheveux blonds.
« Ma cendre sera plus chaude que leur vie » Anna de Noailles :
telle était l’épitaphe dont rêvait Séverine, libertine au grand coeur et à la plume téméraire, née le 27 avril 1855, à Paris, dans une famille de petits bourgeois lorrains (père fonctionnaire à la préfecture de police), sous le nom plus banal de Caroline Rémy. Il est des êtres qui ont, comme disait le poète surréaliste Raymond Roussel, « l’étoile au front », Séverine, elle, naquit la liberté au cœur. Elle ne va pas à l’école, mais apprend à lire dans Le Siècle et la comtesse de Ségur. Son père Onésime, qui ressemble « en chauve et en moins gai » à M. Carnot » lui fait apprendre en de tristes pensions le latin et le grec, le piano, et l’emmène au Louvre. La mère l’emmène au Théâtre français, elle voudrait bien devenir actrice. Toute petite déjà elle court chez les forains pour se faire « enlever par les Bohémiens ».
Premier acte pour une jeune fille de l’époque : le mariage avec un employé du gaz, M. Montrobert, 30 ans, elle en a 16 ; trop vite, trop jeune, c’est un échec, la nuit de noce est un désastre, elle demande la séparation (1873). Pour le divorce il faudra attendre dix ans la loi de M. Naquet. Elle a un garçon, Louis, remis au père qui le confie en nourrice. Séverine revient dans sa famille et se nourrit de « petits boulots ». Lectrice chez une riche veuve, elle s’éprend du fils Adrien Guebhardt et tombe à nouveau enceinte. L’enfant, Roland, naît en Belgique, de père inconnu, et c’est la grand-mère qui s’en occupe. A Bruxelles, chez un ami commun, Caroline rencontre Jules Vallès, député de la Commune de plus de 20 ans son aîné, dont l’exil cesse le 13 juillet 1880. Il rentre alors à Paris. Il la fascine, elle veut devenir journaliste, sa famille s’y oppose, elle se tire une balle qui rate le cœur et écrit à Vallès un poulet enflammé : « Je meurs de ce qui vous fait vivre de révolte et de haine … Je meurs de n’avoir été qu’une femme alors que brûlait en moi une pensée virile et ardente ». La famille cède : elle va travailler avec le vieux communard. De la Commune, elle ne se rappelle qu’une chose : quand elle faisait de la charpie pour les blessés, elle a découvert l’horreur des guerres devant un écolier dont la cervelle coulait sur le cartable.
La rencontre avec Vallès
En 1881 (elle a 26 ans –date aussi du Congrès anarchiste de Londres), elle devient « le » secrétaire de Vallès (qui la nomme « graine d’aristo, fleur de fusillade »), auteur d’une trilogie célèbre (l’Enfant, le Bachelier, l’Insurgé), et son chemin bifurque : avec lui, deux ans plus tard, elle fonde Le Cri du peuple – financé en partie le docteur Adrien Guébhard. C’est, selon la définition de C. Douyère-Demeulenaere, « un journal d’unité socialiste, [...] socialiste révolutionnaire, [...] ni anarchiste, ni blanquiste, ni possibiliste, ni guesdiste ». Le premier numéro de ce quotidien paraît le 28 octobre 1883. Séverine (qui avait d’abord pris le pseudonyme Séverin, pour faire plus masculin) va y tenir une chronique régulière, « Les idées d’une Parisienne ». Il faut souligner combien la presse écrite joue à l’époque un rôle central, chez les bourgeois comme chez les gueux. On lit tout, de la première à la dernière ligne. Séverin elle-même a appris à lire avec son père dans Le Siècle.
Entrée au service de Vallès déjà malade comme secrétaire, on murmure que c’est elle qui termine la rédaction de L’Insurgé. Elle met de l’ordre et sabre dans « les mots boiteux et les lignes bossues » que lui remet Vallès dans la fièvre du griffonnage des idées. Ils se parlent souvent « de cheveux gris à cheveux blonds », expression qui revient sous leur plume.
Mais – et c’est l’une des premières raisons du silence qui entoure souvent Séverine – l’accent est mis sur Vallès, comme d’ailleurs dans le livre récent Séverine et Vallès de Christine Douyère-Demeulenaere, où il est surtout question de Vallès et de son entourage au Cri du Peuple. Ensuite, en contrepoint, se dessine déjà l’un des paradoxes, l’une des ambiguïtés de Séverine : le journal est payé par un jeune médecin de riche famille, Séverine vient de la petite bourgeoise, a des goûts de luxe, elle aime les hommes et surtout c’est un oiseau libre qui déteste toute pensée embrigadée, du genre de celles défendues par des « croque-morts » à la Jules Guesde – de ceux « qui en disant ‘Egalité !’ tirent les heureux de ce monde vers le gouffre, la ruine, la mort ».
Elle est d’une grande beauté, avec des yeux bleu délavé outremer, une bouche pulpeuse, des cheveux mousseux blond vénitien, un port sinueux et plein de grâce, une voix douce et qui captive, une « voix de menteuse », et surtout elle est douée d’une incomparable faculté d’écoute. Sans parler de son humour corrosif et de ses accès de gaieté fort contagieux.
Cette jeune femme ravissante et déterminée devient vite célèbre dans Paris puisque Renoir en commence le portrait en 1885, l’année même où Vallès meurt (en février) d’une crise de diabète au 77 boulevard Saint-Michel, domicile de Séverine et du docteur Guebhardt.
« 15 février 1885. Vallès repose sur le lit blanc. Les portes de la chambre mortuaire ont été ouvertes. L'escalier est plein de monde. Au pied du lit, on a disposé de grosses touffes d'immortelles rouges que Séverine distribuera en souvenir de lui, aux citoyens en redingote ou bourgeron venus saluer un dernier coup l'écrivain révolutionnaire.
Deux ouvriers ont déposé dans l'antichambre leurs trousses pleines d'outils. Ils entrent, la casquette à la main, et leurs yeux sont remplis de larmes. Ils tirent de dessous leur blouse un petit bouquet qu'ils posent, timidement, à côté des fleurs somptueuses; mais Séverine va mettre le petit bouquet à la place d'honneur: entre les mains, si blanches, de Vallès. Les deux compagnons éclatent en sanglots: «Ah! citoyenne...»
Une vieille en bonnet s'avance: «Savez-vous, dit-elle à Séverine, qu'il m'a donné un drapeau à tenir, le 26 mars 1871, jour de la proclamation de la Commune?»
[…] Et l'on entend la grande rumeur du peuple de Paris, en bas, qui se prépare à faire au Réfractaire les funérailles d'un roi.
Le lendemain, Eugène Pottier publiait sa chanson, dans Le Cri du Peuple:
[…]Et cent mille hommes réveillés
Accompagnent au cimetière
Le Candidat de la Misère
Le Député des Fusillés.
Séverine reprend le journal qu’elle dirigera encore pendant trois ans, luttant sans relâche contre l’influence de Jules Guesde, sectaire et tranchant, qu’elle surnommera le « pharisien social ». L’une des crises les plus féroces naît autour du procès d’un anarchiste, Clément Duval (janvier 1887), une sorte de théoricien du principe d’Arsène Lupin : reprendre aux riches ce qu’ils ont pris aux pauvres. Séverine le soutient, sans adhérer totalement à ses idées et, choisissant la voie de l’anarchisme contre celle de l’idéologie, se voit en prise avec la vindicte de Guesde, qui part fonder La Voie du Peuple, d’une violence si extrême qu’il ne convainc personne et disparaît assez vite. Séverine ose écrire à l’époque ce qui devrait rester l’adage de bien des journalistes : ma pensée demeurait indécise, mon jugement demeure incertain. »
Autre scandale : Interviewée par Arthur Meyer, elle reconnaît préférer le Général Boulanger, ministre de la guerre, à Jules Ferry (fautif à ses yeux de l’aventure coloniale, en particulier du Tonkin) et elle se laisse embaucher dans son journal « réactionnaire », Le Gaulois, sous le pseudonyme de Renée - tandis qu’elle signe Jacqueline au Gil Blas. Mieux encore : Dans un jeu de billard plein d’esprit, Renée et Jacqueline écrivent sur Séverine. Renoir achève son portrait. C’est cette même année 1888 que, par l’intermédiaire du député du Vaucluse maître Laguerre, elle fait la connaissance de Marguerite Durand, qui épouse de ce dernier. Coup de foudre intellectuel entre les deux femmes ! Séverine décrit Marguerite, sur ce ton de complicité féminine sans ambiguïté où la beauté fait partie des attraits et atouts reconnus par une femme à une autre femme : « Fine créature mince comme un jonc, au teint à peine rosé, […] nimbée d’un or si pâle et de fils si ténus qu’on eût cru une chevelure de jeune enfant, les yeux couleur de ciel, toute de grâce et de fragilité ! » Marguerite a 9 ans de moins et Séverine se plaît à jouer les aînées, avec tendresse et protection. Et c’est ce qui explique en grande partie l’affaire du ralliement à Boulanger, ce populiste que défend L’Intransigeant de Rochefort, où le député du Vaucluse auquel succède Laguerre, M. Naquet, celui de la loi sur le divorce.
Le ralliement de Séverine au boulangisme, avec un article pourtant fort réservé du 9 janvier 1888 provoque sa démission du Cri du Peuple en août 1888 : le journal ne lui survivra qu’un an jusqu’au 10 juin 1889. Et pourtant, là encore, on l’accuse de méfaits tout autres : ne voilà-t-il pas qu’elle distingue le peuple de la foule et précise, mettant déjà en garde Boulanger : « Général, vous avez avec vous la population, cette masse irrésolue et flottante qui crie vive celui-ci, vive celui-là. […] Mais c’est la foule, cela, ce n’est pas le peuple. » Car Séverine déjà aime les gens, au fond de toute origine, le peuple, elle n’aime ni les hordes, ni les sectaires. On le lui fait payer cher. C’est l’élection de Boulanger à la Chambre, sa marche triomphale, même Lafargue écrit à Engels que Boulanger fait figure de « l’homme du peuple par opposition à Ferry », la fondation du journal La Cocarde (ainsi baptisé par Séverine), avec pour symbole l’œillet rouge qu’elle porte à la boutonnière et qui devient l’œillet du ralliement. Refusant de marcher sur l’Elysée, Boulanger loupe le coche, est condamné à mort par contumace à Paris tandis qu’il s’exile à Bruxelles avant de se tuer sur la tombe de sa maîtresse.
« L’école buissonnière de la Révolution »
Désormais, Séverine en a soupé de l’aventure commune. Elle a « fait jeter 400 000 francs dans Le Cri du Peuple. Ceux du doux Adrien. Son dernier éditorial le dit : « Il y a bien autre chose que moi en jeu, dans ce mal de haine dont le socialisme est en train de mourir. [Tant que les meneurs du socialisme n’auront pas senti le péril de ces discordes qui, comme la gangrène, envahissent tout le parti ; tant qu’ils n’auront pas abdiqué leurs ressentiments, comme jadis les nobles abdiquèrent leurs privilèges dans la nuit du 4 août […] les pauvres resteront sans espoir et sans pain.[…] On n’y débat plus les intérêts économiques des travailleurs, mais les intérêts électoraux des candidats. Entre leurs mains, le socialisme n’est plus un but, il est un instrument. […]J’aime l’indépendance de l’adversaire autant que la mienne propre ; je conçois que le cerveau du voisin ne soit pas moulé sur le mien. Nous sommes comme cela dans la famille ; Vallès réclamait la ‘liberté sans rivages’ et, sous la Commune, était le seul à protester contre la suppression du Figaro et du Gaulois.»
Pour les mêmes raisons elle avait refusé de se présenter lorsque, en août 1885, les femmes de la Fédération républicaine et socialiste, avaient décidé de présenter des candidatures féminines aux élections : « J e suis restée trop femme pour n’être pas de beaucoup au-dessous d’une tâche qu’une citoyenne plus virile accomplira certes mieux que moi.[…] J’ai trop d’amour de mon indépendance pour l’engager en quoi que ce soit et envers qui que ce soit. » « Il n’y a que les huîtres et les sots qui adhèrent », elle serait d’accord avec cet adage de Valéry.
Désormais, elle doit gagner sa vie par sa plume, va s’y employer et, ce qui est difficilement concevable aujourd’hui va le faire dans tous les journaux ou presque. Elle se déploie comme grand reporter, sur le terrain, parmi ceux qu’elle observe. Dans Le Cri, elle inaugure ce que nous appellerions le grand reportage sur le terrain , allant visiter les décombres fumantes de l’Opéra Comique qui vient de flamber, faisant 200 morts : elle s’imprègne du lieu, elle imagine l’épouvante, elle la vit.
Ainsi, en 1889, après un terrible accident qui fait cent morts d’un coup de grisou à Saint-Etienne, Séverine va plus loin, elle descend dans la mine. Et puis, elle lance une souscription dans Le gaulois : la reine du Portugal ou Mme Boucicaut patronne du Bon Marché envoient de l’argent ! Voilà le « miracle Séverine », l’abolition de la lutte des classes au nom de l’être humain », même si elle reste toujours du côté des pauvres, des victimes. Elle couvre aussi pour Le Journal la grève des « casseuses de sucre » de la rue de Flandres, déguisée en ouvrière – et déjà on pense à toutes ces jeunes bourgeoises déguisées en ouvrières comme Claire Etcherelli ou d’autres : « L’idéal serait de passer ignorée, anonyme, […] flot incorporé dans l’océan, haleine confondue dans le grand souffle humain. »
En 1890, le beau Georges Labruyère - qui avait connu Séverine à la mort de Vallès en l’interviewant pour L’Echo de Paris et avait vécu avec elle dans un ménage à trois « scandaleux » puisque, en 1885, Séverine a épousé Adrien Guebhardt - est accusé d’avoir aidé à l’évasion d’un anarchiste polonais qui a tué un général russe. Un ami de celui qu’on a fait fuir, a entrevu Séverine dont il écrit qu’elle lui est apparue comme une révolutionnaire au sens ‘nihiliste’ du mot, gaie, agissante et prévoyante. » Ce côté comploteur et vaguement sanguinaire de Séverine n’est pas l’un des aspects les moins intrigants de sa personnalité.
Labruyère sera lavé de tout soupçon, mais trop tard : Séverine est mise à la porte du Gaulois, et immédiatement embauchée à L’Eclair.
Les ragots vont bon train contre les amants qui vivent sous la houlette du mari et Séverine en gardera sa réputation de « jouisseuse », elle qui au fond n’a vraiment vécu qu’avec deux hommes, auxquels elle fut fidèle de manière différente. Cette réputation infâme est bizarrement reprise en écho par PPDA, souvent plus favorable aux femmes, dans son roman où elle couche avec un typo, comme une vraie dévergondée. Labruyère n’est pas bien flambant, mais il n’est pas lâche, c’est un bretteur usuel et redouté : il se bat en duel pour Séverine, et la féministe Mme Astié de Valsayre reproche à Séverine de ne pas se battre elle-même ! Cette dame a d’ailleurs déposé à la Chambre une pétition exigeant que l’on puisse porter culotte. Séverine rétorque qu’elle ne veut en aucun ressembler à une de ces « chienlits de carnaval » ! Ce n’est pas ainsi, selon elle que l’on peut rendre service aux femmes, ni même aux « féministes », comme le mot va être lancé en mai 1892 !
En juillet 1892, Séverine commence à prendre quelques distances avec l’anarchisme, elle qui avait tancé les bourgeois pour leur peur et recommandé « On n’en a peut-être plus pour longtemps ? … Mettons les baisers doubles » : juste après l’exécution de Ravachol, l’attentat du restaurant de la rue de Véry fait deux morts et une blessée (une enfant). La même année, elle soutient la cause de la première avocate soutenant sa thèse, Jeanne Chauvin, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Elle défend l’avortement (il faut dire qu’elle n’aime guère les enfants !) en écrivant – ce qui aujourd’hui prend une autre sonorité : « Lorsqu’ils ont placé leur honneur sous le cotillon des femmes, les hommes auraient dû songer en même temps à ne pas imputer de crime et à ne pas frapper de châtiments tout acte commis par la femme pour sauvegarder l’apparence de cet honneur-là. »
Boulevard Montmartre, elle mène grand train de vie pour pourvoir aux frais de sa mère, de son amant et de ses deux fils. Sans parler de Coco Bleu le perroquet et des trois chiens Rip, Tiote et Mégôt, bâtards sauvés de la fourrière et de la mort – elle écrira plus tard en hommage à l’un de ses chiens, passion qu’elle partage avec Louise Michel – Sac-à-tout (1906). Plus tard, elle sauvera de la mort l'âne de Pierrefonds, épuisé d'avoir tiré des charrettes, le bapisera Cadichon et l'emmènera tirer son petit chariot ... de pic-nic.
Pour gagner sa vie, elle écrit beaucoup et on lui reprochera d’avoir collaboré deux longues années au journal fort antisémite La Libre parole de Drumont! Drumont l’exonère lui-même en écrivant cette curieuse phrase : « A la femme, même la plus admirablement douée, il manquera toujours pour comprendre l’antisémitisme, la connaissance du côté scientifique et ethnique de la question. » Cela fait partie, une fois encore des ambiguïtés de Séverine : n’est-elle pas l’amie de la femme écrivain Gyp, anti-sémite féroce, ou de Déroulède ? Et puis il ne faut pas oublier que Drumont est … un socialiste, qui, dénonçant la fusillade du 1er mai, écrit cette infamie : « une baronne juive a fait chiper les cheveux dorés de Maria Blondeau pour s’en confectionner une perruque ! »
Accusation dont elle se lavera au moment du procès Dreyfus et de son engagement parmi les dreyfusards dans La Fronde. Elle continue à voler au secours de l’innocent poursuivi et assassiné. Alertée, comme Anatole France, Clemenceau ou Jaurès, par le poète Archag Tchobanian, témoin du massacre de 1895 et qui s’est fixé à Paris la même année, Séverine publie le 3 février 1895 dans La Libre parole un article intitulé « Les massacres d’Arménie ». Cet article sera à l’origine de l’engagement de bien des intellectuels, poètes, et personnages de la société parisienne de l’époque. Mais elle coquète beaucoup et un drôle de personnage, journaliste fort connu, Jacques de Saint-Cère, la traite de « Petite Sœur des Riches ». Son implication en janvier 1896 dans le scandale Lebaudy vient-il d’un réflexe de femme furieuse ? Toujours est-il qu’elle écorne à l’époque l’image de Séverine. A l’origine du scandale, ce journaliste, intriguant, maître-chanteur, qui se fait appeler Jacques de Saint-Cère – ça ne s’invente pas ! – et qui a été l’amant de la femme de Sacher Masoch ! Il claque l’argent et vit d’expédients. Accablé de dettes, en 1895, il fait la connaissance de Max Lebaudy, fils du roi du sucre, qui, à 22 ans, se trouve à la tête de 22 millions de francs dont il vient d’hériter. Le Figaro de 6 août publie un article fielleux, « Propos d’un grincheux » accusant le jeune homme de se faire dispenser à coups de mensonges et de prébendes du service militaire, au prétexte qu’il serait malade. Séverine et d’autres journalistes reprennent l’accusation. Or ils ignorent un détail dramatique : le jeune Lebaudy est très gravement malade. Saint-Cère fait chanter Max Lebaudy pour inverser la campagne et retourner l’opinion. Trop tard : le jeune homme meurt d’une typhoïde mal soignée le 24 décembre 1895, veille de Noël, à l’hôpital militaire d’Amélie-les-Bains. Octave Mirbeau comprend le premier et crie au scandale contre les médecins militaires. « Madame Séverine, elle-même, nous conta l’hiver dernier, d’horribles mais rapides drames de la mort dans les casernes ». Toujours est-il que Séverine dut regretter sa promptitude à enfourcher les dadas d’un maître-chanteur. Car, parmi les accusés, figure Georges de La Bruyère. Mais Mirbeau défend à son tour Saint-Cère, jeté en prison et que tous vilipendent. Séverine dut se justifier et chiffrer le montant de ses dons aux pauvres grâce à ses articles.
1897 : La Fronde
La fondatrice de La Fronde, Marguerite Durand, que l’on surnommait en 1888, quand Séverine la rencontra, « la muse du boulangisme », était née le 24 janvier 1864. Enfant illégitime, comme George Sand, comme Flora Tristan (1804-1844), comme Louise Michel (1830-1905), élevée au Couvent des Dames Trinitaires, elle était entrée à la Comédie Française, où elle jouait les ingénues. Puis elle avait épousé Laguerre, ce brillant député, partisan du Général Boulanger. "La muse du boulangisme" avait publié alors quelques papiers dans le journal de son mari, La Presse puis était entrée au Figaro, où elle avait créé la rubrique "Courrier".
Envoyée spéciale au Congrès Féministe International de 1896 où les étudiants avaient prévu de « faire un chahut », elle se passionne et lance un grand quotidien « sérieux » (qu’elle s’offre avec son collier de perles) rédigé et dirigé entièrement par des femmes, La Fronde, qui paraît de 1897 à 1905, avec pour collaboratrices Séverine qui rédige les « Notes due frondeuse », Marcelle Tinayre, Pauline Kergomard, Lucie Delarue-Mardrus, Andrée Viollis, Clémence Royer (traductrice de l'œuvre de Darwin en français et première femme à donner des cours - de philosophie - en Sorbonne) et bien d’autres. Elle se battent pour que les femmes puissent être décorées de la Légion d’Honneur (Jeanne Loiseau, alias Daniel Lesueur, romancière et l’une des premières femmes à recevoir la Légion d’Honneur collabora à La Fronde), entrer aux Beaux-Arts, devenir avocates (Jeanne Chauvin, avocate et une des toutes premières femmes inscrites au barreau de Paris ), pharmacienne (Blanche Galien fut la première), astronome (Mlle Klumke, première admise à l’Observatoire de Paris) …
Marguerite Durand écrit : « La Fronde était un journal comme les autres journaux…pas plus amusant !! On y trouvait matière à discussion, non à plaisanterie. Vite, elle fut baptisée : « Le Temps en jupons ». Cette critique était le seul compliment qu’elle pouvait ambitionner.
Être pris au sérieux, être compté, dès son début, parmi les journaux importants, parmi les grands journaux, c’était un succès inespéré. » Le journal coûte cher, l’argent vient souvent du député Viviani, dont on murmure qu’il aurait des tendresses pour Marguerite. A l’époque, le nerf de la guerre des femmes vient souvent des hommes.
La prouesse
La prouesse de La Fronde déjà, ce fut de n’être ni féministe ni féminine mais, d’incorporer les méthodes nouvelles du reportage, l’irruption de la réalité, le passage comme le dit une commentatrice américaine de l’acting à l’acting up, avec cette spécificité chez la plupart d’entre elles d’user de leurs charmes comme d’une arme féminine de la part de celles qui n’entendaient pas non plus être les « singes des hommes ». Depuis 1881, le journalisme échappe à la censure du gouvernement, depuis 1882, par la loi Camille Sée, les femmes ont le droit à l’éducation (même si certains secteurs comme les mathématiques leur restent interdits) et par la loi Naquet, au divorce. N’oublions pas que nous sommes à l’époque de « Frou-Frou » où l’on se demandait si une institutrice pouvait monter à bicyclette. La Fronde, elle, accusait les hommes d’avoir créé une « femme » à l’image qu’ils voulaient s’en faire, et même, ce qui est amusant à relire aujourd’hui, Marie-Anne de Bovet s'attaquait à Proudhon, connu pour avoir lancé la phrase « ménagère ou courtisane » !
« Le mélange de dragon combatif et de mère exprime pour la plupart la politique éditoriale de La Fronde. […] Le coup de pierre de La Fronde avait la douceur d'une caresse d'éventail », commentait un journaliste en 1903 quand le journal a cessé d'être édité. […]Le but n'était pas de donner plus clairement un « vrai » sens de « la femme », mais de rendre les femmes visibles à travers la richesse de leur diversité. »
On doit à Marguerite Durand, entre bien d’autres choses, la création du cimetière zoologique d’Asnières en 1899, et la première Bibliothèque féministe française officielle.
Séverine s’était lancée dans la bataille de l’Affaire Dreyfus, du côté des dreyfusards, elle y avait connu le journaliste Bernard Lazare et participé à la fondation de la Ligue des droits de l’homme - ce qui la tiendra éveillée devant les dérives du parti communiste quand elle s’en rapprochera -, elle a traîné son ennui à Rennes « la ville neuve aux mornes murailles blanches, de la vieille ville aux mornes murailles noires ». Heureusement, le soir, elle joint les copains à l’auberge des trois-Marches, QG des dreyfusards où l’on chante et l’on rit.
En octobre 1903, Marguerite Durand, à sec, doit interrompre la diffusion de La Fronde, faute d’abonnées, et le fait avec ce mot : Le féminisme doit à mes cheveux blonds quelques succès … Je sais qu’il pense le contraire : il a tort. »
Avec le « progrès », la presse a changé et Séverine en est à écrire une « Lettre décourageante » à une postulante journaliste. « La liberté de la presse figure en texte dans la légalité ; jamais en fait elle n’exista moins. […]Le tyran s’est subdivisé en un groupe de maîtres, sa monnaie ; le patron responsable s’est changé en l’insaisissable société anonyme. » Alors Séverine se recycle dans les tournées de conférences. Avec sa voix qui n’a pas faible : « Elle chante plus qu’elle ne parle », son élégance théâtrale, sa taille bien prise et sa force de conviction.
1905 : Séparation de l’Eglise et de l’Etat, mort de Louise Michel
A l’enterrement au cimetière de Levallois de celle qui, en 1883, inventa le drapeau noir en accrochant le voile de deuil qu’elle porte depuis la Commune à un bâton, se pressent 100 000 personnes. « Adieu à la Louise de la misère et de la miséricorde, décharnée par la famine et vibrante comme la révolte. »
Pour Séverine comme pour le philosophe Alain, « Penser c’est dire non » : le 21 avril 1912, à Lyon, elle est présente à l’inauguration, en présence de Justin Godart et d’Edouard Herriot, du monument dressé en l’honneur de Laurent Mourguet, l’inventeur de Guignol. Le reporter du progrès, décrivant la scène, fait allusion à « une journaliste parisienne de passage répondant au nom de Séverine dont le chapeau, aujourd'hui ne passerait pas inaperçu ».
En 1914, elle tourne en faveur des suffragettes, auxquelles s’oppose l’antiparlementaire Colette, Sarah-Bernhardt ou Mistinguett qui déclare « Je m’en fous ! », et pour lesquelles se prononcerait la duchesse d’Uzès rappelant toutefois que Mme de Sévigné siégea aux Etats de Bretagne.
Farouche pacifiste, elle condamne le gouvernement d’Union Sacrée, composé de ministres issus aussi bien de la gauche que de la droite et célèbre la paix en ces termes : « On sait que tu as la saveur des fruits, le parfum des fleurs, le goût du froment, l’éclat des roses, l’or du soleil et la douceur des nuits – puisque rien de tout cela n’est plus et que tu n’es plus là. Tu portes en toi tout le bienfait : le calme du sommeil, la sécurité de l’amour, la solidité du toit et du foyer. ».
Enthousiasmée par la Révolution russe de 1917, elle rejoint le Parti Communiste en 1921 et est deux ans journaliste à L’Humanité. Puis elle quitte le Parti qui ne veut pas adhérer à la Ligue des Droits de l’Homme : « Qu’on me persuade, je ne demande pas mieux. Que l’on me somme, je me rebiffe ! »
En 1920, elle alerte l’opinion en faveur des Arméniens, étant l’une des premières, avec Paul Painlevé ou Victor Bérard, à parler des massacres des Arméniens par les Turcs, le premier déjà, celui de 1898. Mais elle ne se laisse toujours pas embrigader : 1923 « Je ne suis pas maçonne, tout rite m’écarte ».
Elle a encore, dans un article du 28 novembre 1925, de dénoncer le fascisme, « la ligue des intérêts menacés, des peurs, des privilèges, des rancunes, des préjugés, de la routine et de l’incompréhension […] ils reprennent au pluriel le cri sauvage de Médée «’Nous seuls et c’est assez !’ ».
En juillet 1927, elle participe au meeting pour sauver Sacco et Vanzetti.
Sa face d’ombre réapparaît lors des derniers articles, dont le dernier dans Paris-Soir, le 11 février 1929, où elle défend l’assassin d’une mère qui avait refusé au monsieur la main de sa fille, « joueur élégant que la veine a trahi … et que l’on suicidera. ». Son vieil adage, celui qu’elle avait écrit pour défendre son premier anarchiste, lui tourne parfois la tête : « Avec les pauvres toujours ! malgré leurs fautes … malgré leurs crimes ! ». Séverine s’est parfois trompé de pauvres.
Maison Séverine à Pierrefonds
Elle mourut en 1929, à Pierrefonds, non loin de Compiègne, où elle passa les 25 dernières années de sa vie, dans une auberge qu’elle avait achetée et baptisée « Les trois marches ». Ce fut sa maison que choisit sa grande amie Marguerite Durand, devenue sa voisine, pour en faire la résidence d’été des femmes journalistes. Séverine fut enterrée, avec une hirondelle morte du matin, un samedi « pour que les travailleurs puissent assister à la cérémonie » (E. Le Garrec).
L’amant était mort (quand les petites-filles venaient on le dissimulait derrière les persiennes) et le mari était venu mourir auprès de son Aimée, le 28 mai 1924, près 35 ans d’absence. Et quand on pense qu’on l’avait traitée de « chienne rouge qui comptait ses amants aux tours des girouettes ».
Elle avait publié près de 6000 articles qui firent d’elle une grande artiste de son temps. Elle publia des recueils de chroniques comme "Les Pages Rouges" (1893) rassemblant les papiers du "Cri du Peuple" ou "Notes d’une fraudeuse" (1894), des récits à caractère autobiographique "Line" (1921).
Une rue de Paris porte son nom (entre la rue Guynemer et la rue Ernest Renan).
Et sa petite-fille lui a dédié un livre.
Ainsi reste en filigrane dans les mémoires celle qui s’écriait lorsqu’on voulut la décorer de la Légion d’Honneur : « Moi une rosette sur la poitrine ? Mais la nature m’en a déjà donné deux ! »
NOTES
1.Evelyne Le Garrec, Séverine, une rebelle, 1855-1929, Le Seuil, 1982. Séverine, du Cri du Peuple à la Fronde, Choix de Papiers, annotés par Evelyne Le Garrec, Tierce, 1982. Textes abondamment cité aussi dans Paul Couturiau, Séverine l’Insurgée, publié … à Monaco, Le Rocher, 2001.
2. Christiane Douyère-Demeulenaere, Séverine et Vallès. Le Cri du Peuple, Paris, Éditions Payot, Collection « Portraits intimes », 2003
3. Hôtel Colbert, rue du Croissant.
4. Plus tard, Rodin fera d’elle trois dessins. Et un portrait d’elle par Hawkins dort dans les réserves du Musée Carnavalet.
5. «Le Candidat de la Misère... Le Député des Fusillés» : Souvenirs sur Jules Vallès par Maximilien Gauthier, Gavroche, numéro 39, mai 1945.
6."J'ai trop l'horreur des théories et des théoriciens, des doctrines et des doctrinaires, des catéchismes d'école et des grammaires de sectes pour argumenter et discutailler à perte de vue sur l'acte d'un homme que le bourreau tient déjà par les cheveux, et que tous avaient le droit d'injurier et de réprouver, sauf nous!"
7. (in "le cri du peuple", à propos de Clément Duval, 30 janvier 1887)
8.l’une des victimes
9.« L’annonce d’un congrès féministe m’eût donc, comme tant d’autres, laissée indifférente si je n’eusse lu dans un journal d’alors que les étudiants avaient résolu d’y aller faire du « chahut ».
10. "Ce fut avec l’espoir de m’amuser beaucoup des plaisanteries de ces messieurs et de l’émoi des bonnes dames qui en devaient être l’objet, que je me dirigeai vers l’hôtel des Sociétés Savantes.
J’en revins dans des dispositions très différentes. Le premier moment de tumulte passé, chacun s’était vite aperçu que le bon sens n’était pas du côté des tapageurs et prenait intérêt à ce que disaient à la tribune, éloquemment ou de façon naïve, des femmes venues de toutes les parties du monde pour exposer les revendications de leurs sœurs opprimées.
Méditer sur la justesse de ces revendications, en reconnaître le bien fondé et considérer comme un devoir social d’aider à leur triomphe par leur divulgation, voilà ce qui m’amena à concevoir l’idée d’un grand journal féministe où, quotidiennement, des femmes défendraient les intérêts des femmes.
Dans mon écrin étaient vingt-deux perles patiemment collectées une à une pendant des années. Perles sans défaut, perles parfaites de forme et d’orient et destinées à composer un collier rare. Leur prix fut le capital de la Fronde.[…] La 9 décembre 1897 paraissait le premier numéro du quotidien dirigé, administré, composé uniquement par des femmes. » Les bureaux étaient au 14 rue Saint-Georges à Paris.
11. Jean Rabaud, Marguerite Durand, 1864-1936. La ‘fronde’ féministe ou « Le Temps’ en jupons, L’Harmattan, 1996.
12.Mary Louise ROBERTS, « Copie subversive : Le journalisme féministe en France à la fin du siècle dernier », Clio, numéro 6/1997, Femmes d'Afrique. Excellent article de Marie Louise ROBERTS, Associate Professor dans le département d'histoire à Stanford University en Californie, auteur de Civilization Without Sexes : Reconstructing Gender in Postwar France (1994). Traduction Dominique Royce. [En ligne], mis en ligne le . URL : http://clio.revues.org/document390.html.
13. Ferdinand Buisson, Victor Bérard, Paul Painlevé, Séverine, Pour l’Arménie indépendante, Paris, Ligue des droits de l'homme et du citoyen, 1920
14. Jeanne Witta-Montrobert, La Lanterne magique, Calmann-Lévy, 1980.
|
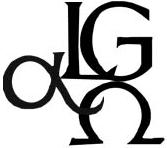
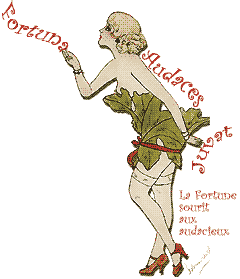
 SEVERINE, LIBRE COMME L’AIR conférence d'E. Antébi sur cette secrétaire-journaliste de Jules Vallès, directrice du Cri du Peuple, chroniqueuse vedette de La Fronde, journal géré et écrit par des femmes, surnommé "Le Temps en Jupons". Cette grande amoureuse, anarchiste mais fille d'un employé de la préfecture de police, pionnière, courageuse, qui écrivait : « J’aime l’indépendance de l’adversaire autant que la mienne propre ; je conçois que le cerveau du voisin ne soit pas moulé sur le mien. » Qui, lorsqu'on lui demandait si elle était franc-maçonne, répondait "Tout rite m'écarte". Qui, adhérente des premiers jours au Parti communiste le quitte peu après quand le Parti refuse d'adhérer aux Droits de l'Homme". Et qui proclamait : « Moi une rosette sur la poitrine ? Mais la nature m’en a déjà donné deux ! »
SEVERINE, LIBRE COMME L’AIR conférence d'E. Antébi sur cette secrétaire-journaliste de Jules Vallès, directrice du Cri du Peuple, chroniqueuse vedette de La Fronde, journal géré et écrit par des femmes, surnommé "Le Temps en Jupons". Cette grande amoureuse, anarchiste mais fille d'un employé de la préfecture de police, pionnière, courageuse, qui écrivait : « J’aime l’indépendance de l’adversaire autant que la mienne propre ; je conçois que le cerveau du voisin ne soit pas moulé sur le mien. » Qui, lorsqu'on lui demandait si elle était franc-maçonne, répondait "Tout rite m'écarte". Qui, adhérente des premiers jours au Parti communiste le quitte peu après quand le Parti refuse d'adhérer aux Droits de l'Homme". Et qui proclamait : « Moi une rosette sur la poitrine ? Mais la nature m’en a déjà donné deux ! »